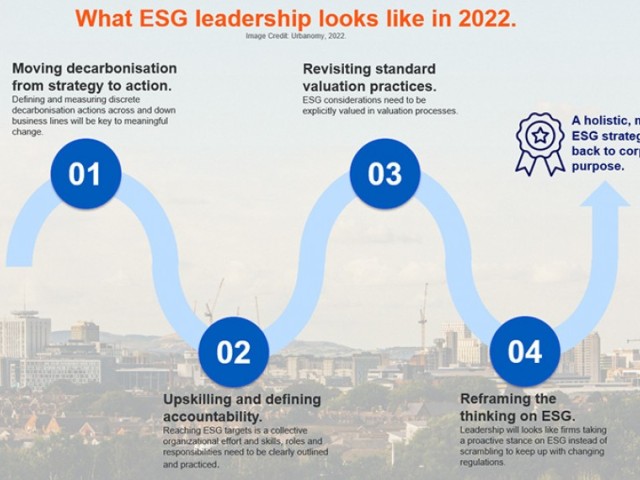25/03/2025
Le 30 janvier 2025, Urbanomy et Oklima organisaient la première édition des Climate Talks, le rendez-vous des scientifiques et des entreprises pour lutter contre le dérèglement climatique et protéger la biodiversité.
Deux tables rondes étaient proposées : "Biodiversité : victime et solution du dérèglement climatique", avec les interventions de Jean Jouzel et Marc-André Selosse, notamment.
La deuxième table ronde était intitulée "Décarboner pour durer : construire des stratégies résilientes" (morceaux choisis en suivant ce lien), avec une introduction de Valérie Masson-Delmotte, directrice de recherche au CEA, Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement ; membre du Haut Conseil pour le climat et directrice du Centre Climat-Société de l’Institut Pierre-Simon Laplace.
Nous reproduisons ci-dessous l’intégralité de son intervention devant la centaine de personnes présentes ce jour-là. Vous retrouverez également en bas de cet article le replay de l'intervention de Valérie Masson-Delmotte (à partir de 1'57).
"Nous sommes devant des efforts sans précédent d'obstruction par rapport à l'action pour le climat"
" Bonjour et merci beaucoup de votre invitation.
Je ne vous cache pas que j’ai besoin de voir de votre part un sursaut. Un sursaut ! On est devant des efforts sans précédent, depuis plusieurs décennies, d’obstruction par rapport à l’action pour le climat.
On avait connu dans les années 1980 l’administration Reagan, la "machine du doute" avec les acteurs des énergies fossiles, notamment américains et un déni par rapport à la réalité des faits scientifiques.
Ça a changé de dimension. Ce qui est très frappant aujourd’hui, c’est qu’on est sur des tactiques d’obstruction.
Si on regarde depuis quinze ans, par rapport à ce que nous savions - scientifiquement, techniquement, économiquement - il y a deux choses qui sont frappantes :
- d’abord, on avait sous-estimé l’aggravation rapide des impacts du changement climatique par rapport à la réalité. Ce n’est pas l’évolution du climat : ce sont les vulnérabilités qui sont présentes partout - les seuils de tolérance - qui sont dépassées et qui conduisent à de la gestion de crise, parce qu’on n’est pas assez adapté à toute la variabilité de ce qui peut se produire dans le climat d’aujourd’hui
- et la deuxième chose qu’on a sous-estimée, ce sont les progrès notamment technologiques qui permettent de rendre accessibles des solutions bas carbone pour répondre aux besoins de base : par exemple l’électrification des mobilités, la production d’électricité décarbonée, renouvelable… il y a eu des progrès considérables.
On est devant une obstruction qui vise à ralentir le déploiement de ces leviers d’action qui sont économiquement viables, en sapant leur crédibilité auprès des décideurs et auprès de l’ensemble des citoyens.
Et l’autre chose frappante, pour moi, ce sont les moments d’événements extrêmes, où justement maintenant on est capable, scientifiquement, d’apporter un diagnostic - vagues de chaleur, pluies extrêmes ou sécheresse agricole grave. En quoi cet aléa fait-il partie de la variabilité naturelle du climat et est un événement rare ? Ou en quoi cet événement a été rendu plus probable, plus intense dans un climat plus chaud comme résultat des conséquences de nos activités ?
La capacité à poser un diagnostic
Scientifiquement, assez rapidement, on est capable de poser un diagnostic. Ça a été fait sur les conditions propices aux incendies en Californie, cette semaine. Ça a été fait sur les pluies extrêmes dans le Pas-de-Calais récemment. Des pluies plus intenses pour lesquelles les outils de protection n’avaient pas été mis en place à hauteur de ce défi.
Et malgré cette capacité à poser assez vite un diagnostic scientifique, qui permet de comprendre par rapport à une exposition à ces aléas, par rapport à des vulnérabilités, en quoi le changement climatique a fait dépasser des seuils de tolérance, on voit également une nouvelle forme d’obstruction. Et vous l’avez certainement vue : au moment des vagues de chaleur en 2022 en France, c’était "oh, on a connu ça en 1976". Ce n’est pas vrai : c’était plus intense.
Au moment de pluies intenses, finalement c’est de prendre des boucs émissaires pour freiner une capacité de délibération démocratique lucide, de regarder les aléas, de regarder l’aménagement du territoire, les expositions qui ont été faites ou les plus vulnérables pour pouvoir les accompagner… c’est de chercher - et c’est ancien comme l’humanité - des boucs émissaires et, dans ces boucs émissaires, il y a maintenant une construction structurée, répandue, qui consiste à placer en bouc émissaire la protection de l’environnement, l’action pour la protection de l’environnement, voire les sciences du climat, de l’environnement, de la biodiversité et le reste.
C’est pour cela que je parle de formes d’obstruction sans précédent qui demandent vraiment de réagir collectivement avec un rôle pour nous, scientifiques, dans nos laboratoires ; un rôle pour les citoyens, un rôle pour ceux qui sont attachés à la vie démocratique, et un rôle important, vraiment important, pour les entreprises.
Cela fait le lien avec la thématique de cette table ronde, "Décarboner pour durer" : décarboner pour durer pour les générations actuelles et futures, décarboner pour protéger les personnes, les activités économiques… et pourquoi le faire ? Par rapport aux conséquences d’un climat qui se réchauffe et à des risques de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles à gérer.

Transcription
La deuxième table ronde des Climate Talks, organisés par Urbanomy et Oklima le 30 janvier 2025, intitulée "Décarboner pour durer : construire des stratégies résilientes". De gauche à droite : Lucie Raty (Urbanomy), Valérie Masson-Delmotte (CEA, Haut Conseil pour le climat), David Meneses (OPmobility), Jules Chaillé (Fnac Darty), Isabelle Spiegel (Vinci, au micro) et Emmanuel Normant (Saint-Gobain).
Photo : Maxime Fiston / Nome Visuals.
Photo : Maxime Fiston / Nome Visuals.
La deuxième table ronde des Climate Talks, organisés par Urbanomy et Oklima le 30 janvier 2025, intitulée "Décarboner pour durer : construire des stratégies résilientes". De gauche à droite : Lucie Raty (Urbanomy), Valérie Masson-Delmotte (CEA, Haut Conseil pour le climat), David Meneses (OPmobility), Jules Chaillé (Fnac Darty), Isabelle Spiegel (Vinci, au micro) et Emmanuel Normant (Saint-Gobain).
Photo : Maxime Fiston / Nome Visuals.
Photo : Maxime Fiston / Nome Visuals.
Le réchauffement climatique est en 2025 à son niveau attendu pour 2030-2035
Je voudrais donc revenir sur 2024, encore une année record au niveau du climat planétaire. Pour la première fois, le niveau de réchauffement observé sur une année a dépassé 1,5°C. Ça ne veut pas dire que ce niveau de réchauffement a été atteint au sens "climat", puisqu’on a une variabilité naturelle qui se superpose aux tendances dues à l’accumulation de chaleur, dû à l’effet des activités humaines sur le climat.
Donc le réchauffement dû aux activités humaines, c’est en gros 1,3°C, maintenant. Et puis à cela se superpose cette variabilité naturelle.
Mais je vous demande quand même de méditer : aujourd’hui, dans un monde 1,3°C plus chaud, le réchauffement qu’on observe en France, c’est déjà 2,2°C. C’est plus fort que la moyenne planétaire et c’est ce qu’on attendait dans la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique, dont se dote le gouvernement français. Mais c’est ce qu’on attendait dans un monde 1,5°C plus chaud vers 2030-2035.
Donc la trajectoire de référence qu’on ancre dans le cadre public, qui doit axer, aussi, collectivement, la manière d’anticiper les caractéristiques climatiques à venir, il faut le voir comme assez conservateur puisqu’en France on est déjà dans ce qui était attendu à horizon 2030-2035.
Et les trois dernières années, 2022, 2023, 2024, je ne sais pas si votre mémoire vous permet de vous rappeler ce qui s’est produit :
- 2022, vague de chaleur, sécheresse, rupture d’approvisionnement en eau, difficultés de transport sur le Rhin qui touchent toute l’activité économique, forte dégradation des forêts, des zones humides, mais aussi incendies de forêt difficiles à gérer en métropole
- 2023-2024, pluies extrêmes, les inondations dans le Pas-de-Calais, encore maintenant en Bretagne. La sécheresse grave dans les Pyrénées-Orientales, à Mayotte, encore maintenant une sécheresse grave en Guyane, à La Réunion…
Juste pour souligner qu’on fait face dans les conditions récentes aux conséquences d’un cycle de l’eau plus intense, plus variable, dopé - à la fois pour les sécheresses et pour les pluies extrêmes - par un climat plus chaud.
Et ce qui est frappant, c’est que ces trois dernières années, leurs niveaux de température, dans un monde 2 degrés plus chaud, vers 2050, ce sera représentatif du climat moyen dans l’état de nos connaissances.
Donc qu’est-ce que ça veut dire de s’adapter à un climat qui change ? C’est tirer le retour d’expérience de ce qui n’a pas marché déjà, mais c’est aussi de se dire quelles vont être les années record, les événements inédits à venir à mesure du réchauffement planétaire.
Et puis si on atteint 3 degrés d’ici à 2100 - l’extrapolation des politiques publiques déjà mises en œuvre (si on ne les détruit pas) - à ce moment-là les années record 2022, 2023, 2024 en France, ce seraient des années exceptionnellement fraîches.
Vous voyez, en fait, ce que veut dire un demi-degré de plus au niveau planétaire par rapport aux conditions qu’on va percevoir dans différentes régions.
Revendiquer l’héritage des Lumières et le "droit à la science"
Alors je veux parler de science, puisque plus que jamais je pense qu’on a besoin de revendiquer notre héritage des Lumières. Notre héritage des Lumières, c’est une construction de la place de la science par rapport aux obscurantismes, une construction, aussi, du respect pour les droits humains, et parmi les droits humains fondamentaux il y a le droit à la science, d’ailleurs – je ne sais pas si vous êtes familiers avec cette notion-là mais c’est important : on produit des connaissances pour la société, qui appartiennent à tout le monde, aux citoyens.
Et comme on fait face à une forme d’obscurantisme technophile aux États-Unis, c’est bien de rappeler la place de la science et des faits dans la société pour la prise de décision ; c’est d’ailleurs ce que le Haut conseil pour le climat fait maintenant en rendant son avis sur la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Je vais parler de cet aspect qu’on a peu esquissé tout à l’heure : il y a le rôle des scientifiques, qui produisent des connaissances ; il y a le rôle des entreprises, qui développent les solutions, qui créent de l’activité, qui créent de la prospérité, de l’emploi et tout le reste. Et puis il y a aussi le rôle des régulateurs : le cadre commun qu’on se donne, le rôle des États qui fixent un cap, et ce cap est important.
La montée en puissance des sciences de l’attribution
Ce que j’ai compris c’est que le monde de l’entreprise n’aime pas tellement l’incertitude mais plutôt une certaine confiance dans un cap clair qui ne va pas fluctuer avec les hasards de dissolutions et tout le reste.
Je veux parler, donc, d’un mot et d’un concept scientifique qu’on appelle l’attribution.
Qu’est-ce que c’est que l’attribution ? Vous avez un système complexe, des évolutions observées et vous cherchez à comprendre la cause des évolutions observées : est-ce que ce ne sont, pour le climat par exemple, que des fluctuations spontanées ? Est-ce que ce sont des facteurs naturels ? Ou est-ce que c’est l’influence humaine qui agit sur le climat ?
Et donc les sciences de l’attribution, dans les sciences du climat, se sont construites depuis des décennies. Elles ont été formalisées à partir des années 1990 et ce sont elles qui permettent d’avoir ce constat très clair de l’influence humaine sur le climat planétaire, qui est la seule cause de l’accumulation de chaleur dans le système climatique - ça a valu le Prix Nobel de Physique en 2021 au chercheur allemand Klaus Hasselmann.
Et maintenant ce sont ces sciences de l’attribution qu’on mobilise sur des événements extrêmes pour arriver à discerner en quoi ils ont été rendus plus probables, plus intenses, mais aussi en en tirant les leçons : quelles seront les caractéristiques dans un monde 1,5°C ou 2°C plus chaud, dans une décennie, dans trois décennies, etc.
Donc on relie observation, attribution, projection pour construire une information qui puisse permettre de s’inscrire sur le retour d’expérience des impacts vécus ou évités, pour nourrir la réflexion, la gestion de risque, un travail d’analyse des vulnérabilités pour construire une adaptation qui soit efficace, de sorte que l’on ne se prépare pas seulement aux événements qu’on a déjà connus mais à des événements qu’on n’a pas connu dans un contexte donné, pour être résilients.
Pour moi, c’est ça, l’adaptation. Ce n’est pas simplement réagir après coup ; c’est, aujourd’hui, la capacité de transformer, c’est-à-dire d’utiliser des connaissances, des retours d’expérience dans d’autres contextes sur des événements qu’on n’a pas encore connus en s’appuyant sur des éléments de connaissances concrets, opérationnels, de terrain, dans vos entreprises, et puis des connaissances scientifiques de sorte à pouvoir mettre en place des actions qui vont renforcer la résilience à venir.
Et puis l’attribution, en fait, ce n’est pas que ça. L’attribution c’est aussi, pour des politiques publiques, arriver à mesurer leur efficacité : ce qui a déjà été mis en place depuis le protocole de Kyoto, l’accord de Paris. Ça a porté des fruits - insuffisants, mais des fruits.
On a réussi à éviter d’émettre, collectivement, 4 à 8 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, chaque année. Et on peut le tracer : politiques publiques d’efficacité, cadre réglementaire, normes, pratiques. Évolution des mix énergétiques : des sorties du charbon et puis, maintenant, du pétrole, et bientôt du gaz. Lutte contre la déforestation…
On voit ce qui fonctionne et on voit qu’on peut le détruire très facilement.
De l’attribution à l’adaptation
Et puis le dernier volet c’est l’attribution par rapport à la gestion de risques ou aux actions en matière d’adaptation. Là, on a un gros retour d’expérience sur la prévision météo. Sur l’alerte précoce, la capacité à mettre à l’abri les biens, les personnes, et on sait que sur l’alerte précoce, pour un euro "investi" on économise sept euros, quasiment.
On l’a moins sur la construction de l’adaptation à des horizons temporels plus longs, c’est-à-dire à l’échelle de temps du changement climatique. Et on a besoin de retours d’expérience concrets, d’acteurs économiques, pour être capables de mieux mesurer l’efficacité d’investissement dans une adaptation transformatrice et en mesurer les bénéfices.
Il y a déjà des retours d’expérience sur la gestion de crue, sur la gestion d’incendie, les systèmes de détection précoces, etc. Le pré-positionnement dans des régions qui n’étaient pas toujours touchées précédemment. Donc on a déjà des retours d’expérience mais je pense qu’il y a besoin de faire avancer collectivement ces sciences de l’attribution, de l’efficacité, des investissements, des pratiques, des savoir-faire, des compétences, des mises en œuvre sur l’adaptation.

Transcription
Lors de la première édition des Climate Talks, organisés par Urbanomy et Oklima, le 30 janvier 2025 à Paris. De gauche à droite : Hélène Valade (groupe LVMH, de dos), Benjamin Mousseau (Urbanomy), Jean Jouzel (Conseil économique, social et environnemental, de dos), Thomas Bladier (Oklima) et Valérie Masson-Delmotte (CEA, Haut Conseil pour le climat).
Photo : Maxime Fiston / Nome Visuals.
Photo : Maxime Fiston / Nome Visuals.
Lors de la première édition des Climate Talks, organisés par Urbanomy et Oklima, le 30 janvier 2025 à Paris. De gauche à droite : Hélène Valade (groupe LVMH, de dos), Benjamin Mousseau (Urbanomy), Jean Jouzel (Conseil économique, social et environnemental, de dos), Thomas Bladier (Oklima) et Valérie Masson-Delmotte (CEA, Haut Conseil pour le climat).
Photo : Maxime Fiston / Nome Visuals.
Photo : Maxime Fiston / Nome Visuals.
Et dans les entreprises ?
Je partais de ma perspective, celle des sciences du climat, car c’est ce que je sais faire. Mais on peut le prendre d’un autre côté : dans vos domaines d’activité, dans vos champs de compétence, quels sont les seuils de tolérance des organisations dans lesquelles vous travaillez ? Qu’est-ce que ça peut être, un seuil de tolérance ?
C’est, par exemple, la santé au travail. Les conditions très chaudes, très humides, des bâtiments absolument inadaptés : vous mettez en danger les collaborateurs.
Ça peut être également des seuils de tolérance sur des infrastructures critiques interconnectées. Et on voit bien, en fait, quand on a une défaillance des réseaux électriques, on a une défaillance des télécommunications, des systèmes d’approvisionnement en eau… ça devient totalement ingérable, on ne peut même pas intervenir.
Donc en regardant comment ces infrastructures critiques ont été dimensionnées, quelles sont leurs plages de tolérance sur la chaleur extrême (50°C à Paris, par exemple), leurs seuils de tolérance par rapport à des risques d’inondations, et donc comment ces infrastructures sont pré-positionnées pour assurer un maximum de robustesse à différents horizons temporels : c’est ça qui peut permettre d’identifier, aujourd’hui, où sont les vulnérabilités, d’en tenir compte, d’aller chercher les connaissances pertinentes, et ensuite de faire évoluer par exemple le cadre réglementaire pour faire en sorte de mieux dimensionner ces infrastructures.
Alors là c’est le côté "risques physiques directs" mais bien sûr il y a aussi des vulnérabilités par rapport aux chaînes d’approvisionnement. Les exemples qu’on peut donner, c’est la flambée du prix de l’huile d’olive avec les conditions de production en Méditerranée, la flambée du prix du café… les inondations en Thaïlande, à l’époque, qui avaient complètement perturbé les chaînes d’approvisionnement en disques durs parce que c’était concentré à un seul endroit dans le monde.
Et donc tout ce volet d’interdépendances, de chaîne de valeur avec aussi l’état des écosystèmes, les ressources en biomasse, les produits de la mer… tout ce qui est fragile dans un climat qui se réchauffe, qui demande à être géré de manière durable, ce sont en fait des seuils de tolérance ou des fragilités dans le fonctionnement des chaînes de valeur.
Si on part de là, on peut aussi aller interroger les sciences du climat sur différents horizons temporels, au fur et à mesure de l’évolution des pratiques, des investissements. En tenir compte pour faire en sorte que le dimensionnement de la manière de travailler intègre ces contraintes à venir et construise une résilience graduelle.
La vraie menace : la fin de la couverture d’assurance
Et puis l’éléphant dans la pièce, que je n’ai pas encore mentionné, c’est l’assurabilité. C’est l’éléphant dans la pièce, on le voit de plus en plus. Aux États-Unis, vous n’êtes pas assurables pour le risque d’inondation en Floride ou le risque d’incendie du côté de la Californie. Le risque, pour les entreprises et pour les particuliers, il est énorme : quand on n’a plus de mutualisation de risques, une explosion des inégalités qui est très, très nette.
C‘est quelque chose qu’on voit également arriver ici. Les communes, les entreprises qui font face à une augmentation du coût de l’assurance, des clauses de contraintes, et peut-être un mécanisme intéressant mais qui n’est pas complètement mis en œuvre : si vous investissez, vous, sur vos infrastructures, sur votre fonctionnement, de sorte à être le plus résilient possible, est-ce que vous êtes récompensés par rapport au montant des primes d’assurance ?
Ce n’est pas nécessairement le cas alors que ça pourrait être un levier d’action vraiment intéressant pour inciter, justement, avec un bénéfice immédiat tangible, à valoriser les investissements qui vont être faits pour réduire les risques liés au changement climatique et renforcer la résilience.
Un cadre réglementaire inadapté
Voilà les points que je voulais souligner : les risques physiques, les infrastructures, la santé, les interdépendances, et je voulais illustrer à quel point on a encore un cadre réglementaire inadapté.
Je ne sais pas si vous avez relu le plan d’adaptation au changement climatique. Avec mon institut, l’Institut Pierre-Simon Laplace - 1 000 chercheurs sur le climat, l’eau, le cycle du carbone, la qualité de l’air en région parisienne - on en a fait une relecture et on a fait un cahier d’acteurs.
Un exemple, parmi quelques dizaines : la norme confort thermique dans les bâtiments, la RE2020, prend pour référence pour huit grandes régions en France, la canicule de 2003 comme référence de la pire vague de chaleur. Mais la canicule de 2003, c’était la pire il y a 20 ans, même 22 ans…
Dans le climat actuel, j’ai des collègues spécialistes des événements extrêmes qui se sont dit : "Quelle pourrait être, ici, la pire vague de chaleur aujourd’hui ?". Leur conclusion, c’est que la pire plausible, aujourd’hui, ce n’est pas celle de 2003 ; c’est 2003 + 4 degrés !
Vous voyez donc que même quand on essaie de rentrer dans un cadre réglementaire pour le bâtiment, pour des enjeux de logements décents, de santé au travail et tout le reste, une norme est en fait décalée par rapport à ce que l’on sait aujourd’hui de ce qui est plausible en matière de pire configuration dans le climat d’aujourd’hui.
En région parisienne, à horizon 2050, on ne peut plus exclure avec les effets d’îlots de chaleur, d’atteindre 50°C. Et donc on voit que là on rentre dans des plages où il faut aller chercher des infrastructures critiques, un travail sur les seuils de tolérance pour éviter des situations très compliquées à gérer. Mais ça peut se planifier, ça peut se mettre en œuvre graduellement.
Voilà les points clés que je voulais souligner. Les enjeux d’anticipation par rapport aux risques, le fait que les risques liés au changement climatique, directs et indirects, via la dégradation des écosystèmes, augmentent de manière disproportionnée pour chaque demi-degré de réchauffement supplémentaire, même chaque dixième de degré de réchauffement supplémentaire !

Transcription
La paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte discute avec deux participants lors de la première édition des Climate Talks, organisés par Urbanomy et Oklima, le 30 janvier 2025 à Paris.
Photo : Maxime Fiston / Nome Visuals.
Photo : Maxime Fiston / Nome Visuals.
La paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte discute avec deux participants lors de la première édition des Climate Talks, organisés par Urbanomy et Oklima, le 30 janvier 2025 à Paris.
Photo : Maxime Fiston / Nome Visuals.
Photo : Maxime Fiston / Nome Visuals.
Une course contre la montre
Il y a un décalage entre l’adaptation qui est réellement mise en œuvre et celle dont on a besoin aujourd’hui. La traduction de ça c’est : crises et pertes & dommages sociaux, économiques, humains.
On est vraiment devant cette espèce de course contre la montre. Et si on n’arrive pas à agir plus efficacement pour limiter l’ampleur du réchauffement climatique, c’est plus de dépenses d’adaptation, de coûts qu’on a encore beaucoup de mal à chiffrer et puis, encore une fois, une escalade des pertes et des dommages, notamment dans des régions qu’on considère comme des points chauds du réchauffement : les régions de montagne, les régions de climat semi-aride ou méditerranéen, les régions tropicales en première ligne et puis également tous les littoraux – parce que pour l’instant on ne le voit pas mais il n’y a pas que les événements aigus, il y a aussi les effets chroniques du réchauffement.
La montée du niveau de la mer en est un, et je finirai là-dessus.
Le rythme de montée du niveau de la mer accélère. Il accélère parce que notre perturbation sur le climat est plus forte et parce qu’on a eu une réponse du Groenland, de l’Antarctique qui n’était pas présente il y a trente ans mais qui est maintenant là et qui y contribue. Et donc on est passé d’un rythme de montée de 2 millimètres à plus de 4 millimètres par an en trente ans. C’est vraiment là une accélération au sens mathématique.
On commence à en voir les premiers effets. Qu’est-ce que c’est ? Des inondations chroniques à marée haute, comme en Floride ou en Guyane ; c’est, lors des tempêtes à marée haute, des records de niveaux marins. C’est, en cas d’inondations, plus de difficultés d’écoulement et de vidange vers la mer puisque le niveau atteint à marée haute est plus fort. De l’érosion pour les côtes sableuses, de la salinisation, des entrées d’eau salée.
On n’en voit que le début et il y a aussi cet enjeu-là à anticiper, sans avoir le retour qu’ont les assureurs sur le coût des dommages - ce n’est pas dans leur radar, parce qu’ils n’ont pas le retour sur expérience. Tout l’enjeu de gestion du littoral, de repli planifié - parce qu’on sait très bien que pour les ouvrages en dur, il y aura des contraintes sur ce qui pourra être déployé, c’est très coûteux – sera d’anticiper cette gestion durable du littoral avec le repli planifié qui est un vrai défi, collectivement, et pour beaucoup d’infrastructures industrielles, de grandes villes qui sont vraiment au ras de la mer.
Utiliser les connaissances produites et réactualiser la prise de décision
Je termine sur ce point-là parce que cela renvoie encore une fois vers les mécanismes de prise de décision robuste devant l’incertitude. Qu’est-ce qu’on va faire en matière d’émissions de gaz à effet de serre ? Parce que des émissions très basses ou très élevées, c’est un facteur 2 sur la montée du niveau de la mer d’ici à 2100 et puis encore plus au-delà.
Et puis une incertitude profonde : que va-t-il se passer du côté de l’Antarctique ? Aura-t-on certains secteurs qui vont démarrer avec des instabilités rapides ? Car là ça peut encore doubler la vitesse et l’ampleur d’ici à la fin du siècle.
On a donc besoin de structurer nos interactions, faire en sorte que lorsqu’on a des progrès et des connaissances, on arrive à mieux les expliquer pour comprendre ce que cela veut dire dans l’état de l’incertitude que nous avons aujourd’hui sur ce sujet-là. Et puis réactualiser les mécanismes de prise de décision et donc les construire de manière agile - pas en mettant tous les moyens dans une direction donnée, mais faire en sorte de pouvoir réactualiser les décisions qui sont prises à mesure de cette évolution des connaissances.
Voilà les points que je voulais partager, qui reflètent aussi beaucoup de réflexion de l’ensemble de la communauté en sciences du climat qui souhaite que les connaissances qu’on produit soient utilisées concrètement - sinon, ça ne sert à rien. Merci ! "

Votre navigateur ne prend pas en compte le javascript.
Pour vous permettre d'accéder à l'information, nous vous proposons de consulter la vidéo Intervention de Valérie Masson-Delmotte aux Climate Talks 2025 dans un nouvel onglet.
Intervention de Valérie Masson-Delmotte aux Climate Talks 2025 d'Urbanomy et Oklima