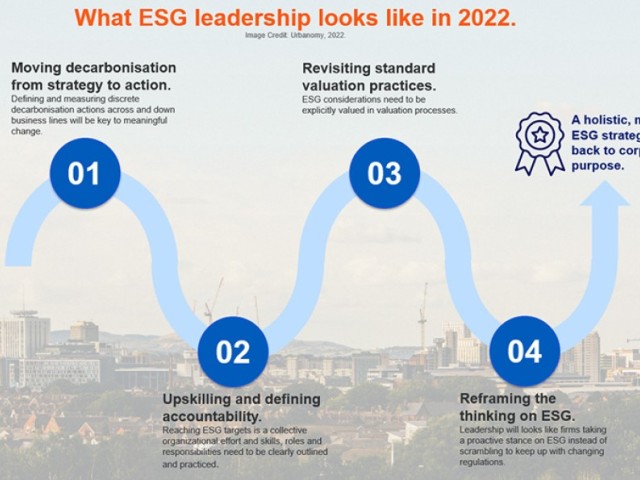Par Félix Briaud
31/01/2025
31/01/2025
Comme chaque année depuis 2019, Ipsos et EDF publient, à l’occasion de la COP des Nations Unies, les résultats de l’Observatoire international Climat et Opinions Publiques.
C’est l’occasion de faire un état des lieux des opinions, des attentes, des niveaux d’engagement et des connaissances de la population sur le sujet du changement climatique.
Cette sixième édition de l’Obs’COP se fonde sur un panel de 23 500 individus âgés de 16 ans et plus, interrogés sur internet entre le 27 août et le 1er octobre 2024. Ces 23 500 personnes sont issues de 30 pays, représentant deux-tiers de la population mondiale, et réparties sur les cinq continents. L’échantillon est représentatif de la population de chaque pays et produit selon la méthode des quotas.
Le changement climatique est la deuxième principale préoccupation dans le monde et la quatrième en France
Ces résultats 2024 nous apprennent d’abord que le changement climatique se hisse moins haut dans les préoccupations en France que dans le reste du monde : le sujet arrive en effet en quatrième position - derrière le coût de la vie (65%), le système de santé (54%), la délinquance (52%) - avec 48% des personnes interrogées se disant préoccupées par le changement climatique en France.
Dans le reste du monde, cette proportion n’est en moyenne que de 45% ; si ce "score" est plus faible qu’en France de trois points, il suffit néanmoins à en faire la deuxième préoccupation des personnes interrogées dans le monde, assez loin derrière le coût de la vie qui, là aussi, est le principal sujet de préoccupation avec 59% des personnes interrogées répondant par l’affirmative.

Transcription
Obs'COP 2024 Ipsos pour EDF : comparaison entre la France et le reste du monde des sujets de préoccupation des 23 500 personnes interrogées
Ipsos / EDF
Plus étonnant est le fait que, malgré les aléas climatiques extrêmes dont la fréquence et l’intensité augmente, lorsque la question est posée à ces Français de connaître leur inquiétude vis-à-vis du changement climatique, l’évolution de leurs réponses connaît une trajectoire dont la baisse est plus accentuée que celle du reste du monde.
En effet, cette inquiétude française baisse assez sensiblement depuis 2022 : cette année-là, 71% des personnes interrogées se disaient "préoccupées" (35% "très préoccupées", 36% "plutôt préoccupées") et 26% "peu préoccupées". La moyenne globale était, elle, de 72% de personnes préoccupées - dont 43% de répondants "très préoccupés".
En 2023, la part des Français préoccupés est ensuite tombée à 68% (moyenne globale 2023 à 73%, +1 point par rapport à 2022) et dans la nouvelle étude Obs’COP, elle se situe désormais à 66%, en baisse de cinq points, donc, par rapport à 2022. Notons que la moyenne globale fléchit légèrement, elle aussi, puisqu’elle est de 71% en 2024, à peu près stable par rapport à 2022 (-1 point) mais en baisse de deux points par rapport à l’an dernier.
Ces cinq points de baisse en deux ans en France se font principalement au bénéfice des personnes affirmant être peu préoccupées par le changement climatique, dont la proportion est passée de 26% en 2022 à 30% en 2024.
Qui doit agir pour lutter contre le changement climatique ? Bien plus que dans le reste du monde, les Français citent les entreprises
Penchons-nous maintenant sur deux questions posées au panel de 23 500 personnes : d’une part, quels sont les acteurs qui doivent, selon eux, agir ; et d’autre part, quels sont les acteurs qui, à leurs yeux, agissent déjà.
S’il est attendu, en France comme dans le reste du monde et à des niveaux très similaires, que le gouvernement soit le principal acteur de la lutte contre le changement climatique (70% en moyenne dans le monde, 69% en France), une différence de taille est à relever s’agissant du rôle des entreprises dans ce domaine.
En effet, parmi les 1 000 personnes interrogées à l’échelle nationale, 58% d’entre elles considèrent que les entreprises doivent agir, plaçant cette typologie d’acteur en deuxième position des réponses à cette question.
C’est, d’une part, bien plus élevé que dans le reste du monde, où 35% seulement, sur un échantillon global de 23 500 personnes, considèrent que les organisations privées et publiques doivent apporter leur pierre à l’édifice de la décarbonation : la demande d’action de la part des entreprises est donc, en France, 23 points au-dessus de la moyenne mondiale !

Transcription
Obs'COP 2024 Ipsos pour EDF : comparaison entre la France et le reste du monde concernant les agents qui doivent agir en priorité, selon les 23 500 personnes interrogées
Ipsos / EDF
D’autre part - et c’est là quelque chose de très significatif - les entreprises sont citées en deuxième position par l’échantillon français, 7 points devant les citoyens-consommateurs (58% vs. 51%), alors que la moyenne mondiale place les entreprises en troisième position, derrière les citoyens-consommateurs.
Cette deuxième place des entreprises au périmètre de la France est, du reste, un constat présent depuis 2022, avec un croisement des courbes observé, cette année-là, entre la courbe des entreprises et la courbe des citoyens-consommateurs - qui s’était effondrée de 12 points dans un contexte de sortie de pandémie de Covid-19 (61% en 2021 et plus que 49% en 2022, tandis que 52% des répondants français disaient attendre en 2022 de l’action de la part des entreprises).
Mais qui agit concrètement ? Les Français estiment que les citoyens-consommateurs sont encore et toujours ceux qui agissent le plus
Le corollaire de cette spécificité française est que, lorsque la question est posée à l’échantillon mondial de 23 500 personnes de savoir si les différentes typologies d’acteurs agissent déjà concrètement pour le climat dans leur pays, les citoyens-consommateurs arrivent assez nettement en tête en France (44%, +4 points depuis 2019), là où c’est le gouvernement, à l’échelle globale, qui est cité comme principal acteur de la lutte contre le dérèglement (55%, +7 points depuis 2019).
En France, un tiers des personnes interrogées, seulement, estime que le gouvernement agit pour lutter contre le changement climatique (33%, stable depuis 2022). C’est un vertigineux écart de 22 points avec la moyenne mondiale, qui place par ailleurs le gouvernement comme les entreprises au même niveau de 33%, bonnes dernières ex-aequo des quatre typologies proposées comme réponses.

Transcription
Obs'COP 2024 Ipsos pour EDF : comparaison entre la France et le reste du monde concernant les agents qui agissent contre le changement climatique dans leurs pays respectifs, selon les 23 500 personnes interrogées
Ipsos / EDF
Autre spécificité française, parmi ces quatre typologies d’acteurs - autorités locales, citoyens-consommateurs, entreprises, gouvernement - aucune ne trouve grâce aux yeux de nos compatriotes : pas un seul ne dépasse les 50% de réponses positives dans l’Hexagone, alors que deux acteurs sur quatre dépassent les 50% lorsque l’on regarde la moyenne globale (en l’occurrence le gouvernement, à 55% comme indiqué plus haut, et les citoyens-consommateurs, à 53%). Râleurs, les Français ?
En résumé, les personnes interrogées en France considèrent que les citoyens-consommateurs sont déjà ceux qui en font le plus, alors qu’ils devraient être selon eux la troisième typologie d’acteurs à agir en priorité. Le gouvernement et les entreprises sont ceux, en revanche, qui agiraient le moins alors qu’ils devraient être les acteurs principalement investis sur cette question. La dichotomie serait-elle révélatrice d’un certain état d’esprit français : en attendre beaucoup du gouvernement et des entreprises et en être, en définitive, souvent déçu ?
Comment agir ? En France, un panel fortement opposé à de nouvelles taxes ou de nouvelles contraintes sur son quotidien
Dans le prolongement de cette spécificité toute française qui considère que ce sont les citoyens-consommateurs qui en font le plus pour lutter contre le changement climatique, les 1 000 personnes interrogées dans l’Hexagone se montrent également assez, voire parfois très opposées, à des mesures consistant à modifier leur mode de vie ou à peser sur leur quotidien au moyen de nouvelles taxes.
Ainsi, une augmentation de l’imposition sur l’enlèvement des ordures ménagères est-elle jugée "plutôt pas acceptable" ou "pas du tout acceptable" par 55% des personnes interrogées, et "plutôt acceptable" ou "très acceptable" par 38% des personnes interrogées – l’adhésion à cette mesure n’ayant quasiment pas évolué depuis l’Obs’COP de l’année dernière (un point d’acceptabilité en plus).
Actuellement testée dans 200 collectivités, la tarification au poids des déchets ménagers, dite "incitative", permettrait pourtant, selon une étude de l’Ademe, de réduire de 30% la part des ordures ménagères résiduelles, comme l’explique cet article du journal Les Échos.

Transcription
Obs'COP 2024 Ipsos pour EDF : opinion des 1 000 personnes interrogées en France au sujet de neuf mesures pouvant être adoptées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
Ipsos / EDF
S’agissant de contraintes imposées aux véhicules 100% thermiques, comme la limitation de l’accès des centres-villes aux seules voitures électriques ou hybrides ou encore l’interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs d’ici 15 ans, elles ne recueillent toutes deux que 34% d’avis favorables et des oppositions respectives de 55% et 54%. Rappelons que l’interdiction de la vente de voitures thermiques neuves est déjà une mesure adoptée à l’échelle européenne et qu’elle doit entrer en vigueur le 1er janvier 2035.
Encore moins populaire est l’hypothèse d’instaurer un péage urbain à l’entrée des grandes villes, idée qui ne recueille que 26% d’adhésion et 64% de personnes interrogées qui la rejettent, estimant qu’elle n’est "plutôt pas acceptable" (26%) ou même "pas du tout acceptable" (38%).
Si les Français expriment à travers ces réponses une opposition au fait de toucher aux déplacements quotidiens, ils se montrent plus réceptifs à l’idée d’agir sur des moyens de transport plus exceptionnels (et plus marqués socialement), comme l’avion : ils sont ainsi 69% à juger acceptable d’interdire les vols courte distance lorsqu’il est possible de prendre le train, pour seulement 22% de personnes interrogées qui y sont opposées.
L’instauration d’une taxe sur les billets d’avion recueille, elle, 52% d’avis favorables contre 39% d’avis défavorables. Ces deux dernières mesures voient néanmoins leur adhésion baisser de 3% depuis l’année dernière ; il sera donc intéressant d’observer l’évolution des réponses à ces deux idées lors de la prochaine étude Obs’COP.
Notons enfin la forte acceptabilité d’une mesure qui consisterait à obliger les propriétaires à bien isoler leur logement : ils sont environ deux fois plus à la juger d’un œil favorable (61%) que de façon défavorable (31%). Comme pour les déplacements en avion, l’on peut supposer que la dimension sociale joue également un rôle ici, car selon ces chiffres de l’Insee de 2023, un peu plus de 57% des ménages possèdent leur résidence principale en France, dans un pays qui compte par ailleurs 40% de ménages locataires (les moins de 3% de ménages restants étant logés à titre gratuit).
La préoccupation vis-à-vis du climat en baisse au sein de toutes les tranches d’âge, mais elle décline moins rapidement chez les jeunes
À regarder de plus près la préoccupation vis-à-vis du changement climatique, la baisse de cinq points observée chez les Français depuis 2022 se retrouve dans presque toutes les composantes de la population française. Il est intéressant, toutefois, de relever quelques différences entre ces segments.
Selon un découpage par âge, par exemple, la baisse est nette auprès des 35-54 ans (64% en 2024 se disent "très préoccupés" ou "plutôt préoccupés" ; ils étaient 72% en 2022, soit 8 points de moins en deux ans) mais également auprès des 55 ans et plus (66% "très préoccupés" ou "plutôt préoccupés" en 2024 ; mais 73% l’étaient en 2022, soit -7 points).

Transcription
Obs'COP 2024 Ipsos pour EDF : préoccupation vis-à-vis du changement climatique par classe d'âge, auprès de 1 000 personnes interrogées en France
Ipsos / EDF
On constate une baisse également chez les moins de 35 ans mais elle est moins accentuée : ils étaient 72% à se dire "très préoccupés" ou "plutôt préoccupés" par le changement climatique en 2022 et ne sont plus que 68% dans ce cas deux ans plus tard ; une chute de 4 points, certes, mais ce fléchissement est environ deux fois moindre, en comparaison, qu’auprès des 35-54 ans ou des 55 ans et plus.
Faut-il donner la priorité à l’environnement ou à la croissance économique et aux emplois ? En France, le clivage entre trois blocs politiques s’accentue depuis deux ans
En se penchant maintenant sur la question de donner la priorité soit à l’environnement, soit à la croissance économique et aux emplois, un phénomène de polarisation de l’opinion selon les affinités politiques s’observe depuis que cette étude a été lancée en 2019. En France, les clivages paraissent s’accentuer depuis deux ans - dans des proportions semblables, et parfois même plus importantes que lors de la période de pandémie de Covid-19.
En 2019, en effet, juste avant que nous ne fassions l’expérience collective d’un confinement généralisé, le "bloc de gauche" (gauche radicale + EELV + PS) était favorable à 64%, en moyenne, au fait de donner la priorité à l’environnement. Ils étaient 45% au sein d’un bloc formé du centre et de la droite traditionnelle (Modem + LREM / Renaissance + Les Républicains) et 43%, enfin, au sein de la droite radicale (Debout la France + Rassemblement National).
Cette année-là, l’écart était donc de 19 points entre le "bloc de gauche", d’une part, et celui du centre et de la droite traditionnelle, d’autre part ; de 21 points entre le "bloc de gauche" et celui de la droite radicale ; et de 2 points seulement entre le bloc formé du centre et de la droite traditionnelle, d’une part, et la droite radicale, d’autre part.
Précisons que nous faisons le choix de rapprocher entre elles ces différentes tendances en raison des compositions de gouvernement constatées depuis le début de cette étude Obs’COP, en 2019.

Transcription
Obs'COP 2024 Ipsos pour EDF : opinion des 1 000 personnes interrogées en France concernant une priorité à donner à l'environnement ou à la croissance économique
Ipsos / EDF
La priorité à l’environnement était donc relativement consensuelle en 2019 au sein des différentes affinités politiques - les trois blocs la plaçant alors d’ailleurs tous au-dessus, en moyenne, d’une priorité à donner à la croissance économique et aux emplois :
- 35 points de plus au sein du "bloc de gauche" en faveur d’une priorité à l’environnement - c’est-à-dire une moyenne de 64% en faveur d’une priorité à donner à l’environnement vs. une moyenne de 29%, au sein de ce même "bloc de gauche", en faveur d’une priorité à donner à la croissance économique et aux emplois
- 5 points de plus en faveur d’une priorité à donner à l’environnement au sein d’un bloc formé du centre et de la droite traditionnelle - c’est-à-dire une moyenne de 45% en faveur d’une priorité à donner à l’environnement vs. une moyenne de 40%, au sein de ce même bloc formé du centre et de la droite traditionnelle, en faveur d’une priorité à donner à la croissance économique et aux emplois
- et enfin 4 points de plus en faveur d’une priorité à l’environnement au sein de la droite radicale – c’est-à-dire 43% en faveur d’une priorité à donner à l’environnement vs. 39% en faveur d’une priorité à donner à la croissance économique et aux emplois.
Si une polarisation de l’opinion, sur cette question précise d’une priorité à donner à l’environnement ou d’une priorité à donner à la croissance économique, s’est fait sentir l’année d’après dans un contexte de pandémie de Covid-19, avec notamment un écart de près de 30 points entre la moyenne du "bloc de gauche" et la moyenne du bloc formé du centre et de la droite traditionnelle (61% vs. 32,5%), les divergences de points de vue semblaient s’être plutôt estompées les deux années suivantes, avec des écarts assez similaires en 2022 - et même parfois moindres – aux écarts constatés en 2019 :
- 14 points d’écart, seulement, en 2022, entre la moyenne du "bloc de gauche" (61%) et celle du bloc formé du centre et de la droite traditionnelle (47%) en faveur d’une priorité à donner à l’environnement
- 21 points d’écart entre la moyenne du "bloc de gauche" (toujours 61%) et la droite radicale (40%) en faveur de cette même priorité environnementale
- 7 points d’écart, enfin, entre le bloc formé du centre et de la droite traditionnelle (toujours 47%) et la droite radicale (toujours 40%)
Ces deux dernières années, néanmoins, les écarts entre ces trois blocs sont très largement repartis à la hausse, et les tendances, soit en faveur d’une priorité à donner à l’environnement, soit en faveur d’une priorité à donner à la croissance économique, se sont nettement accentuées.
Les résultats de cet Obs’COP 2024 permettent ainsi de constater :
Les résultats de cet Obs’COP 2024 permettent ainsi de constater :
- un nouvel écart de près de 30 points entre le "bloc de gauche" et celui formé du centre et de la droite traditionnelle en faveur d’une priorité à donner à l’environnement - 69% de moyenne au sein du "bloc de gauche" vs. 39,5% au sein du bloc formé du centre et de la droite traditionnelle
- un écart vertigineux de 43 points entre le "bloc de gauche" et la droite radicale en faveur d’une priorité à donner à l’environnement, avec 69% de moyenne, toujours, au sein du "bloc de gauche", vs. 26% au sein de la droite radicale - qui privilégie d’ailleurs très nettement depuis 2023 la priorité à la croissance économique et aux emplois
- et enfin un écart de plus de 13 points entre le bloc formé du centre et de la droite traditionnelle (39,5% de moyenne) et la droite radicale (26%) sur la priorité à donner à l’environnement – écart qui n’a jamais été aussi important entre ces deux blocs, sur cette question, même au plus fort de la crise sanitaire
Sur la priorité à donner à l’environnement, la France paraît suivre une polarisation très américaine de l’opinion
L'analyse et le graphe ci-dessous reprennent les rapprochements des affinités politiques françaises définis par l'institut Ipsos pour cette étude et diffèrent donc des rapprochements effectués dans les paragraphes précédents.
Le creusement observé entre ces trois "blocs" de sympathisants de gauche, de sympathisants du centre et de sympathisants de droite s’observait déjà il y a cinq ans aux États-Unis. Il prend désormais de l’ampleur en France, également, dans un contexte de nouvelle accession de Donald Trump à la présidence des États-Unis.
Il n’y avait en effet en 2019 dans l’Hexagone que 15 points d’écart, entre les trois blocs, sur cette question : 56% de sympathisants de gauche pour donner la priorité à l’environnement, 52% de sympathisants du centre et 41% de sympathisants de droite.

Transcription
Obs'COP 2024 EDF / Ipsos : comparaison entre les échantillons français et américains concernant la priorité à donner à l'environnement, évolution entre 2019 et 2024
Ipsos / EDF
En 2024, la part de sympathisants de gauche favorable à donner la priorité à l’environnement a augmenté de 4 points, à 60%, mais dans le même temps la part de sympathisants du centre a décliné de 10 points (42%), tandis que la part de sympathisants de droite répondant favorablement à cette orientation n’est même plus d’un tiers (29%).
L’écart entre les sympathisants de gauche et les sympathisants de droite est désormais de 31 points, deux fois plus important qu’il y a cinq ans – avec des sympathisants du centre désormais plus proches de sympathisants de droite, d’ailleurs, sur cette question de la priorité environnementale : 13 points d’écart en 2024, avec 42% constatés au centre et 29% à droite.
Ces mêmes sympathisants du centre se sentaient pourtant en 2019 plus proches des sympathisants de gauche sur la priorité à donner à l’environnement : 4 points d’écart en 2019 entre le centre et la gauche ; 18 points d’écart, cinq ans plus tard, en 2024.

L'auteur
Félix Briaud
Félix est le responsable communication & RSE d’Urbanomy.
Journaliste durant dix ans, il a ensuite bifurqué vers la data appliquée à la publicité digitale. Ce n’est que récemment qu’il s’est convaincu, en rejoignant le cabinet, de mettre en adéquation sa vie professionnelle avec ses convictions personnelles au sujet de l'environnement.
En dehors de cela, Félix est fou de musique - particulièrement de la période allant des années 1950 aux années 1970. Dans ce domaine comme dans d’autres, il regorge d'anecdotes et sera sans aucun doute ravi de vous en raconter une ou deux.